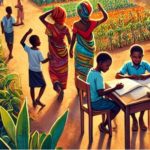La 58ᵉ session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’ouvre dans un contexte délicat pour le Secrétaire général António Guterres. Alors que les enjeux mondiaux en matière de droits humains n’ont jamais été aussi cruciaux, Guterres voit son influence s’éroder, une situation qui pourrait affaiblir sa capacité à orienter le débat international.
Depuis le début de son second mandat, António Guterres fait face à une série de défis qui ont considérablement terni son image sur la scène internationale. Son absence de condamnation explicite concernant l’attaque iranienne qui a conduit Israël à le déclarer persona non grata a suscité de vives critiques. Cet incident a mis en lumière son incapacité perçue à naviguer les eaux tumultueuses de la diplomatie au Moyen-Orient. Sa participation controversée au sommet des BRICS en octobre 2024 a également jeté de l’ombre sur son impartialité perçue. En choisissant de se rendre en Russie alors que la guerre en Ukraine perdure, Guterres a non seulement provoqué l’indignation de Kyiv mais a également suscité des interrogations sur sa gestion des relations internationales dans un monde de plus en plus polarisé.
La perte d’audience de Guterres n’est pas simplement institutionnelle; elle est aussi personnelle. L’homme, autrefois salué pour son pragmatisme et son engagement pour le multilatéralisme, semble aujourd’hui déconnecté des réalités géopolitiques. Son approche prudente, voire hésitante, sur des questions sensibles a conduit certains analystes à parler d’un échec personnel. En tant que leader, son incapacité à fédérer les grandes puissances autour d’une vision commune des droits de l’homme a contribué à l’affaiblissement de l’autorité morale de l’ONU. Le Conseil des droits de l’homme, censé être le pilier de la protection des libertés fondamentales, est désormais confronté à des divisions internes exacerbées par les tensions entre blocs géopolitiques rivaux.
Cette session s’ouvre sur fond de crises multiples : de l’aggravation de la situation en Ukraine à l’escalade des violences au Soudan et au Myanmar. Plus de 80 rapports seront examinés, couvrant près de quarante pays, avec une attention particulière sur les violations des droits de l’homme dans les zones de conflit. Cependant, l’influence limitée de Guterres sur ces discussions pourrait réduire l’impact de ces rapports et affaiblir les résolutions qui en découleront. Sans un leadership fort, le Conseil risque de s’enliser dans des querelles politiques stériles, affaiblissant davantage la crédibilité de l’ONU.
Dans ce contexte, la Suisse émerge comme un acteur clé de la 58ᵉ session. Sous la présidence de l’Ambassadeur Jürg Lauber, Genève devient le centre névralgique des débats mondiaux sur les droits de l’homme. La Suisse, avec son engagement en faveur de l’abolition de la peine de mort, de la liberté d’expression et de la protection des défenseurs des droits de l’homme, cherche à combler le vide laissé par l’affaiblissement de l’autorité de Guterres. En se positionnant comme un médiateur impartial et un défenseur des valeurs universelles, la Suisse pourrait jouer un rôle déterminant pour rééquilibrer les discussions et renforcer la légitimité du Conseil des droits de l’homme.
Alors que la 58ᵉ session du Conseil des droits de l’homme se déroule, l’avenir d’António Guterres à la tête de l’ONU semble de plus en plus incertain. Face à des critiques croissantes et à une influence en déclin, il devra faire preuve de leadership et de vision pour restaurer sa crédibilité. La question demeure : pourra-t-il encore peser sur l’agenda international des droits de l’homme ou assisterons-nous à une réorganisation du leadership mondial dans ce domaine ? Dans un monde de plus en plus fragmenté, le sort de Guterres pourrait bien préfigurer celui de l’ONU elle-même.