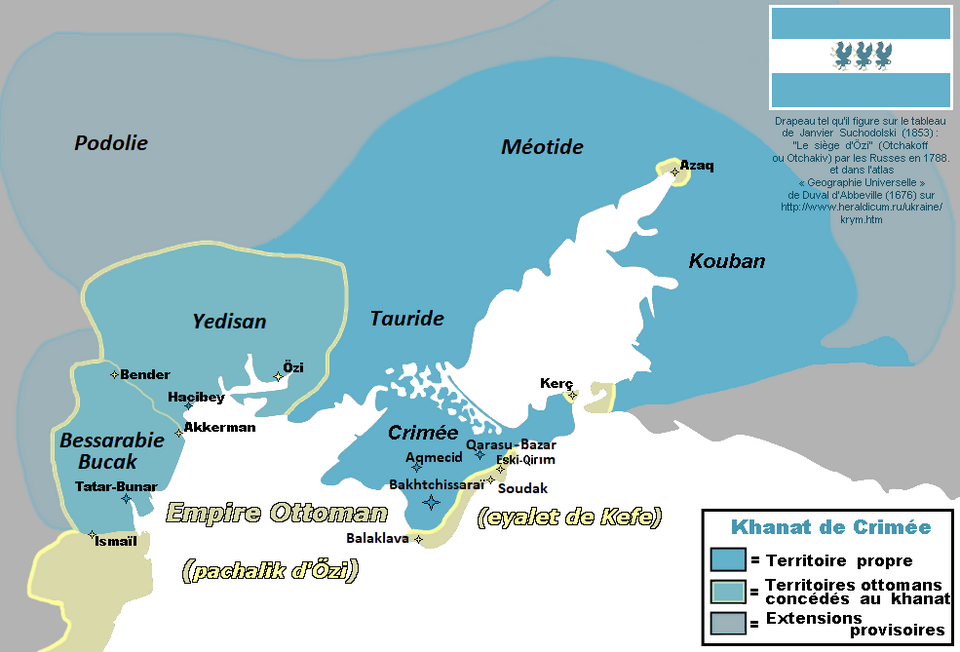À la surprise générale, les organisations d’aide confessionnelles, initialement perçues comme protégées sous l’administration Trump, se retrouvent aujourd’hui confrontées aux conséquences d’un gel massif de l’aide étrangère. Alors que beaucoup s’attendaient à ce que les organisations chrétiennes conservatrices bénéficient d’un traitement de faveur, elles subissent désormais les mêmes coupes budgétaires et obstacles administratifs que leurs homologues laïques.
Lorsque Donald Trump a été réélu pour un second mandat en tant que président des États-Unis, nombreux étaient ceux qui pensaient que les groupes confessionnels, en particulier les évangéliques chrétiens conservateurs, seraient favorisés dans l’allocation de l’aide étrangère. Historiquement, les administrations républicaines ont défendu la liberté religieuse et privilégié les initiatives fondées sur la foi, positionnant ainsi ces groupes religieux comme des acteurs influents du développement international.
En effet, lors de son premier mandat, l’administration Trump avait lancé un programme de 50 millions de dollars par le biais de l’USAID pour promouvoir la liberté religieuse et diversifier les bénéficiaires de l’aide, bénéficiant notamment aux minorités religieuses telles que les communautés chrétiennes et yazidies dans le nord de l’Irak. De plus, le projet 2025 de la Heritage Foundation recommandait de donner la priorité aux organisations confessionnelles, affirmant que la liberté religieuse était liée à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la paix.
Cependant, comme le rapporte le journaliste de Devex, Colum Lynch, les principales organisations chrétiennes d’aide humanitaire, telles que World Vision, Catholic Relief Services et Samaritan’s Purse, se retrouvent aujourd’hui à concourir pour obtenir des dérogations, tout comme les agences laïques. « J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un malentendu », a déclaré Noah Gottschalk de la Hebrew Immigrant Aid Society. « Nous voulions tous croire que… si nous pouvions simplement expliquer que cette pause est réellement préjudiciable, les gens comprendraient et corrigeraient la situation. Mais ce point a été exprimé et il n’est pas entendu. »
Le gel de l’aide a entraîné des situations paradoxales, impactant notamment les initiatives pour la liberté religieuse. Par exemple, Samah Alrayyes Norquist, ancienne envoyée pour la liberté religieuse à l’USAID, a révélé dans Newsmax que l’International Republican Institute (IRI) n’avait pas pu participer au Sommet international pour la liberté religieuse en raison d’un ordre de suspension des travaux du département d’État, alors même que le vice-président JD Vance y réaffirmait l’engagement des États-Unis en faveur des minorités religieuses persécutées.
La crise de financement ne touche pas seulement les groupes confessionnels. Des organisations de tous horizons font face à de sévères restrictions budgétaires, entraînant des vagues de mises en congé et de licenciements. Basée à Nairobi, Amref Health Africa a été contrainte de mettre 692 employés en congé sans solde et de suspendre 20 initiatives dans plusieurs pays. Bien que certaines dérogations aient permis de poursuivre des programmes liés au VIH, l’avenir reste incertain, avec 15 programmes toujours en pause et une perte potentielle de 30 millions de dollars d’aide américaine.
Cette suspension de financement a des conséquences dramatiques pour les populations vulnérables. Au Malawi, plus de 108 000 enfants risquent de ne pas recevoir leurs vaccinations complètes, tandis qu’au Kenya, 175 995 enfants pourraient être privés d’un soutien nutritionnel essentiel. Les effets en cascade se font sentir dans cinq pays africains, affectant près de 500 000 enfants et des milliers de travailleurs de la santé.
Le gel de l’aide de l’administration Trump est en grande partie attribué à Peter Marocco, ancien responsable au Pentagone et au département d’État, qui est devenu le principal décideur en matière d’aide étrangère américaine. Dans une réponse juridique, Marocco a cité une désobéissance au sein de l’USAID pour justifier une politique de congé administratif qui touche 10 000 employés. Il a justifié cette décision en affirmant qu’elle était nécessaire pour « mener un audit complet et sans entrave des opérations de l’USAID. »
Avec des milliers d’employés en congé administratif et plus de 1 600 licenciements définitifs, l’USAID subit une transformation radicale. Seuls 611 employés jugés « essentiels » resteront, notamment ceux chargés de l’aide humanitaire d’urgence et de la sécurité.
Pour plus de détails sur les impacts de ce gel de l’aide, lisez l’article complet sur Devex.
Source : Devex, Anna Gawel, 25 février 2025