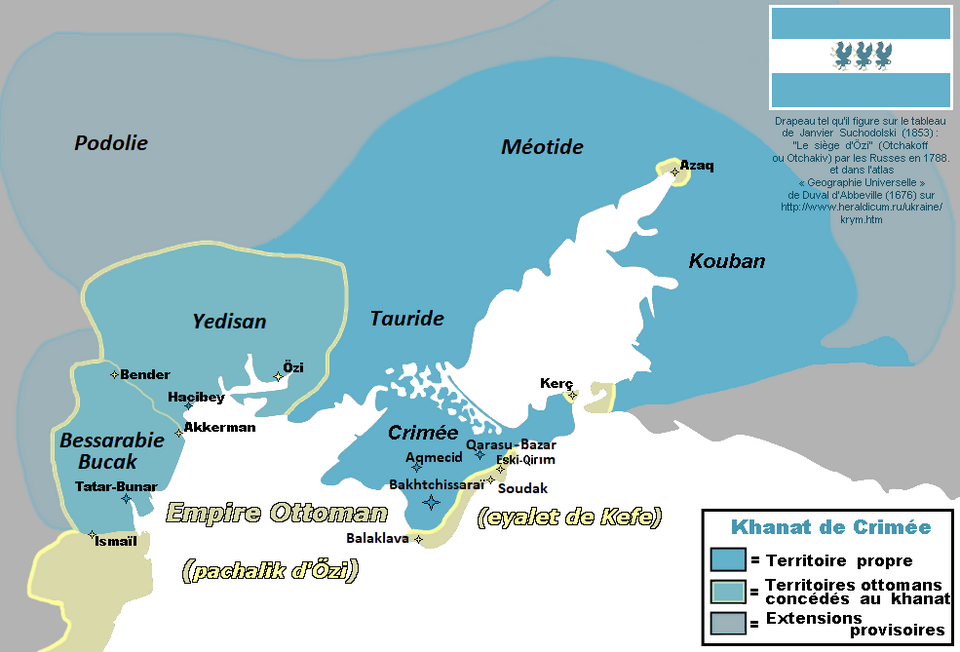Alors que le nouveau gouvernement sri-lankais proclame sa volonté de tourner la page des décennies de guerre civile, de corruption et d’impunité, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU vient de rendre un rapport dans lequel il constate que les engagements se heurtent à la persistance des pratiques autoritaires et aux contraintes de la crise économique.
À Colombo, le discours a changé. L’élection d’Anura Kumara Dissanayake à la présidence en 2024, suivie de la large victoire de sa coalition aux législatives, a fait naître l’espoir d’une refondation politique. Son gouvernement a promis d’abolir la loi antiterroriste héritée de la guerre, de combattre la corruption, d’instaurer une nouvelle Constitution et d’assurer justice pour les crimes passés, y compris les attentats de Pâques 2019. Le rapport présenté à Genève par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme souligne ce « tournant discursif » vers une identité nationale plus inclusive. Mais l’ONU constate surtout la lenteur des réformes et la persistance des violations.
L’impact de la crise économique reste ravageur : pauvreté doublée depuis 2019, malnutrition infantile en forte hausse, dépendance accrue vis-à-vis de l’aide alimentaire. La restructuration de la dette, conclue en 2024 sous l’égide du FMI, saigne les budgets sociaux tandis que 60 % des recettes publiques sont englouties dans le service de la dette. L’imposition de tarifs américains sur les exportations textiles menace un secteur vital pour des millions de travailleuses.
Sur le terrain des libertés publiques, le changement de ton n’a pas dissipé l’ombre des forces de sécurité. Arrestations arbitraires, tortures en détention, morts en garde à vue demeurent documentés. L’abrogation de la loi antiterroriste est sans cesse repoussée tandis qu’elle continue d’être utilisée contre des militants tamouls ou musulmans. Le Haut-Commissariat s’alarme aussi des restrictions contre les ONG, placées sous contrôle sécuritaire, et des intimidations persistantes visant familles de disparus, défenseurs des droits humains et journalistes.
Seize ans après la fin de la guerre civile, les mécanismes de vérité et de réparation restent largement inefficaces. L’Office des personnes disparues n’a élucidé qu’une poignée de cas parmi des milliers, miné par son manque de moyens et de crédibilité. Des charniers continuent d’être exhumés sans que les moyens scientifiques adéquats soient mobilisés. Quant aux procès emblématiques – assassinats de journalistes, disparitions forcées, crimes de guerre – ils piétinent ou s’enlisent dans des acquittements retentissants.
La lutte contre la corruption affiche des gestes symboliques : adoption d’une loi sur les avoirs illicites, condamnation de ministres, lancement d’un plan national anticorruption. Mais ces signaux contrastent avec l’ampleur des intérêts en jeu et l’impunité persistante dans les hautes sphères.
Face à ce constat, l’ONU appelle non seulement à des réformes structurelles — indépendance du parquet, renforcement des institutions de réparation, ouverture aux expertises internationales — mais aussi à une pression accrue de la communauté internationale. Car, derrière le langage nouveau de Colombo, le rapport rappelle que la matrice d’impunité et de contrôle autoritaire survit, héritée à la fois de la guerre et de la crise. Et que les victimes, du nord tamoul aux quartiers pauvres de la capitale, continuent d’attendre vérité et justice.